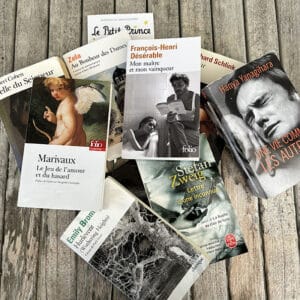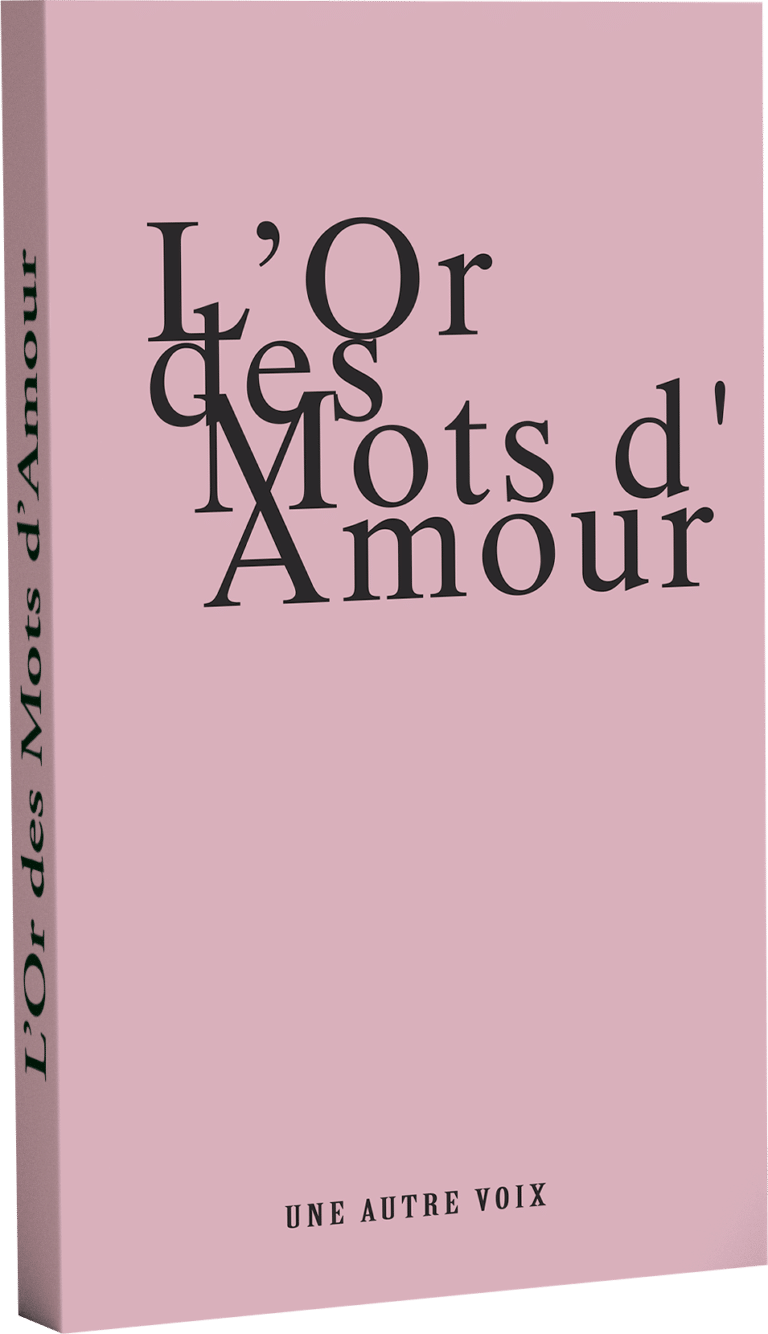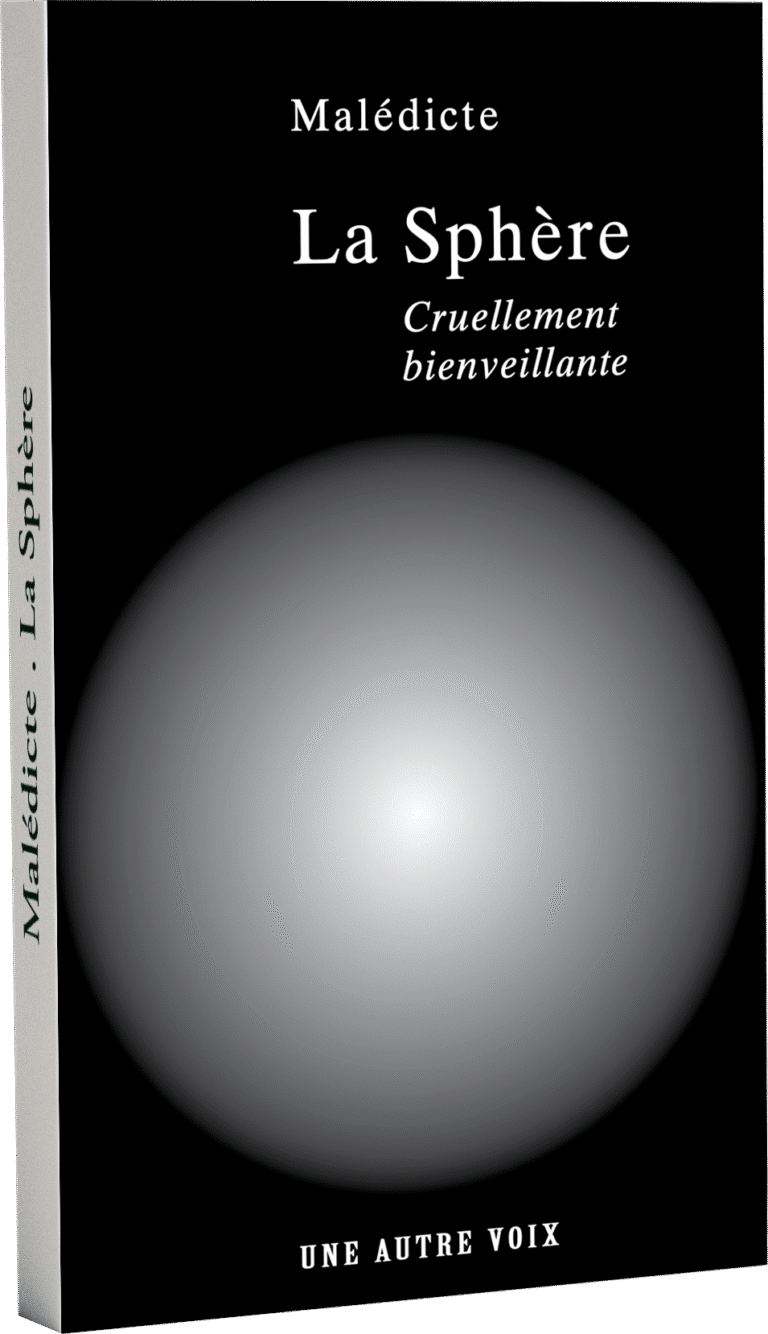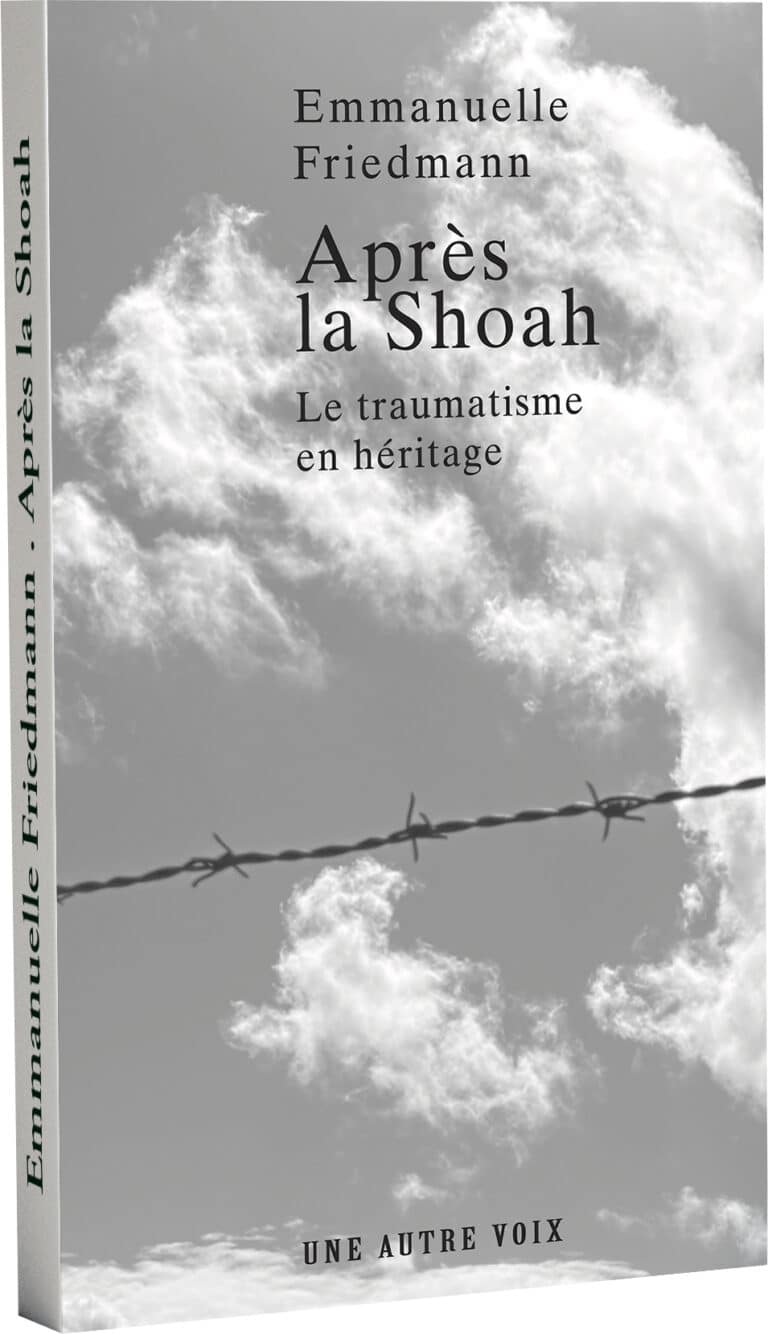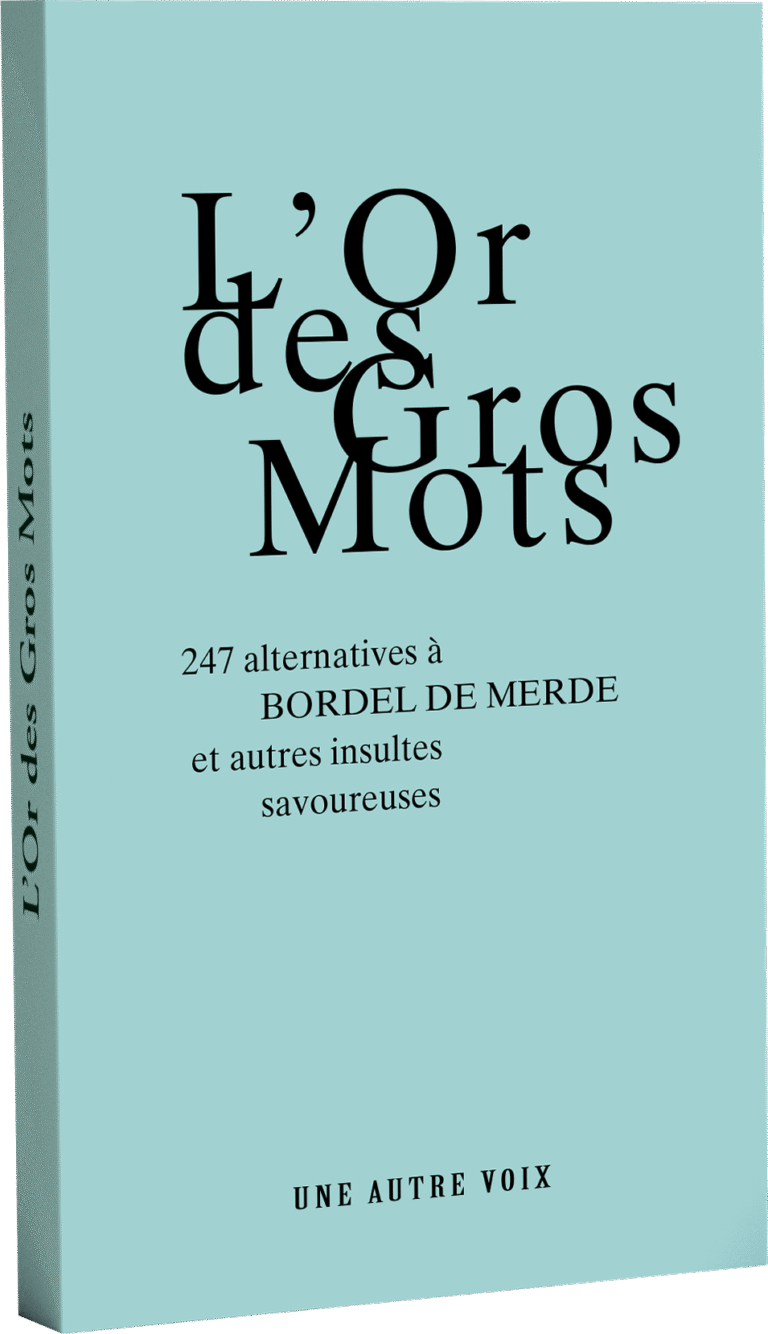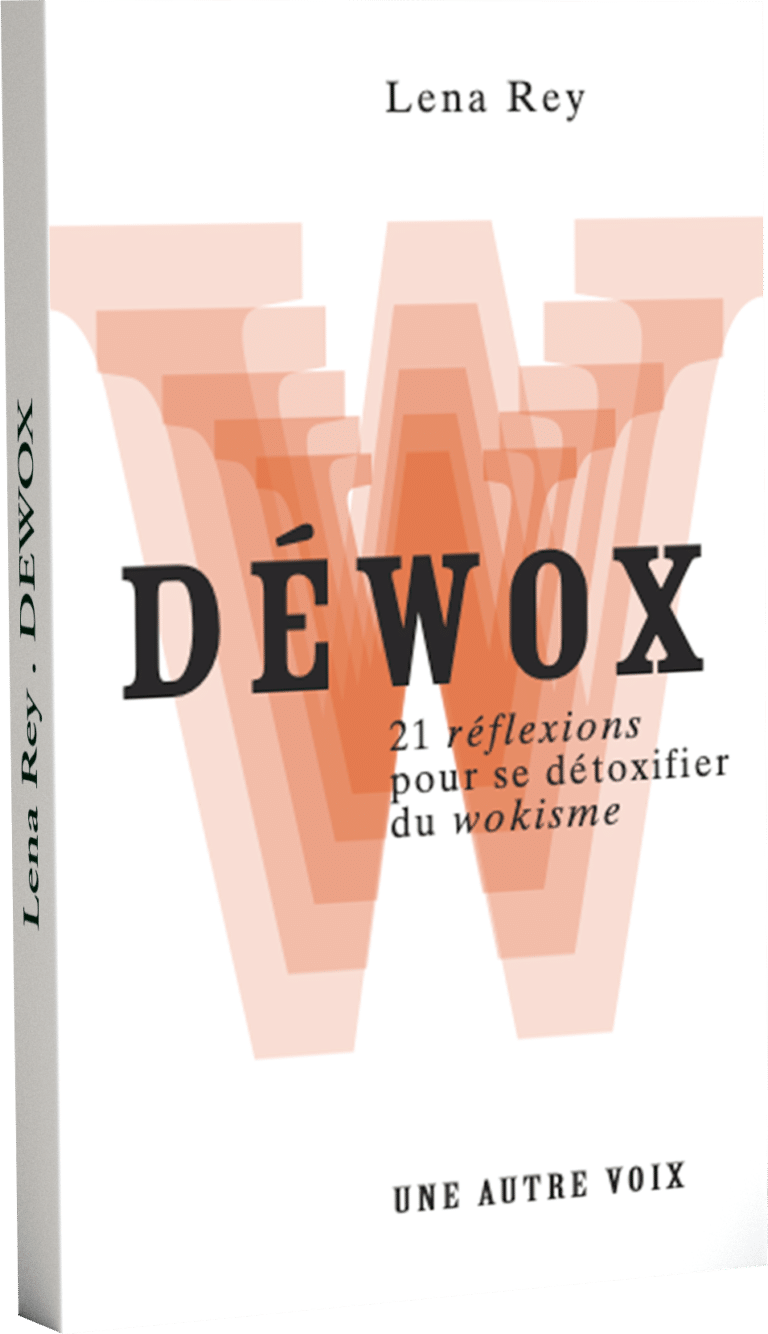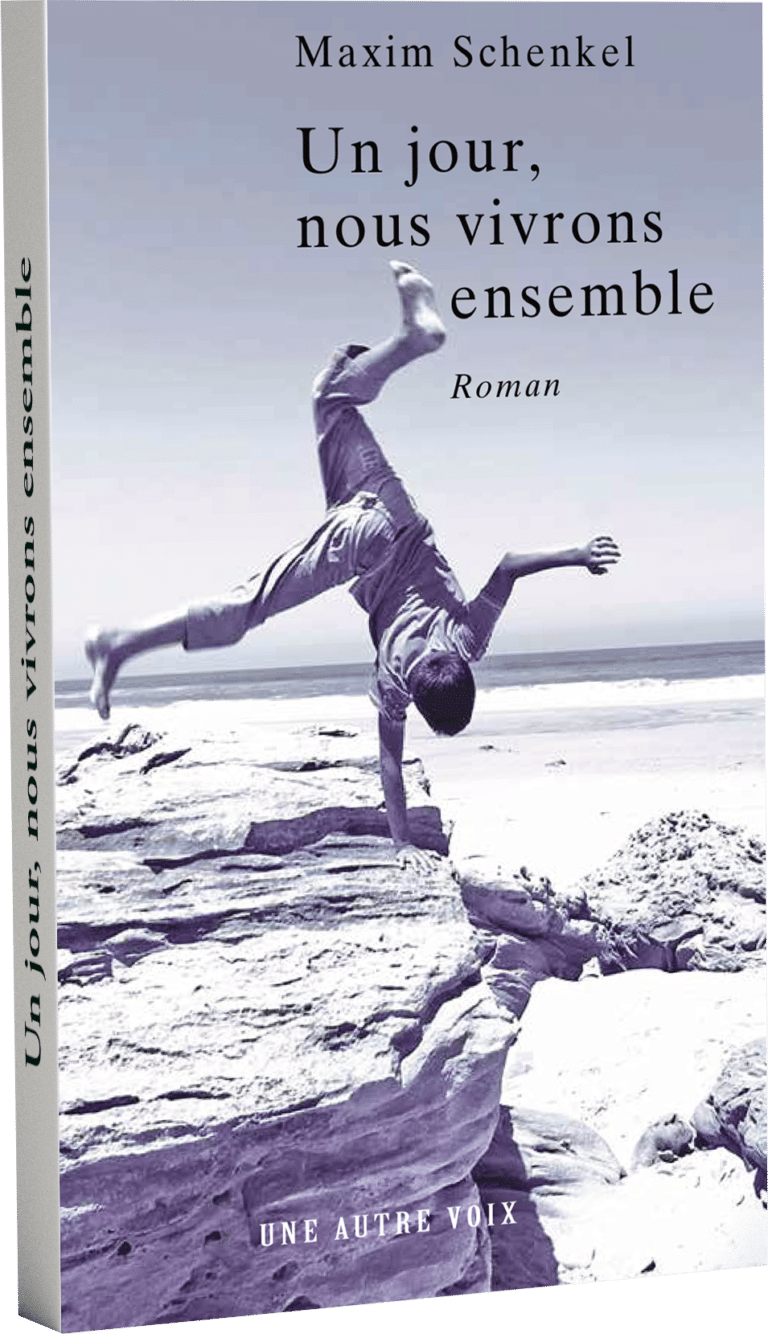Votre smartphone vous « suggère » un restaurant, Netflix vous « recommande » un film et Siri vous « comprend ». Partout, les objets parlent, conseillent, compatissent même. Cette cacophonie d’artifices bavards masque une tragédie littéraire : nous avons perdu l’art véritable de la prosopopée, cette figure sublime qui consiste à prêter une voix aux muets pour révéler l’invisible.
Là où Melville faisait parler la baleine blanche pour interroger notre rapport au mystère, nous laissons les algorithmes susurrer des banalités marchandes. Comment sommes-nous passés de la grandeur poétique à cette ventriloquie commerciale ?
La prosopopée, art ancestral du souffle donné
La prosopopée – du grec prosôpon (visage) et poiein (faire) – est l’art de « faire un visage », de donner une identité parlante à ce qui n’en possède pas. Cette figure transcende la simple personnification : elle révèle une vérité cachée en prêtant une voix à l’inanimé, à l’absent ou à l’abstrait.
Herman Melville maîtrise cet art avec une puissance inégalée dans Moby Dick. Lorsque la baleine blanche « parle » – non par des mots, mais par sa présence obsédante, ses fuites calculées, sa violence soudaine –, elle devient bien plus qu’un cétacé : elle incarne l’inconnaissable, le destin, la nature indifférente aux projets humains. Chaque apparition de Moby Dick résonne comme une parole muette qui révèle l’hubris d’Achab et notre rapport tragique à l’infini.
Cette prosopopée melvillienne ne se contente pas d’animer : elle philosophe. La baleine devient oracle, ses mouvements constituent un langage, son silence même parle plus fort que tous les discours. Melville ne fait pas « parler » sa baleine comme un personnage de Disney ; il lui confère une voix métaphysique qui interroge notre condition.
L’invasion des fausses voix
Mais regardez maintenant ce qu’est devenue cette noble figure. Sur Twitter, McDonald’s « partage » ses émotions, Coca-Cola « comprend » vos moments de bonheur, et votre banque « s’inquiète » de vos finances. Cette pseudo-prosopopée marketing transforme des entités commerciales en faux amis bavards, créant l’illusion d’une relation personnelle là où ne règne que le profit.
Plus pernicieux encore : l’intelligence artificielle qui « apprend », « comprend » et « ressent ». Alexa « écoute » vos préoccupations, ChatGPT « réfléchit » à vos questions, et les algorithmes « devinent » vos goûts. Cette anthropomorphisation technologique nous fait oublier que derrière ces voix de synthèse se cachent des calculs froids et des stratégies commerciales.
L’effet ? Elle nous habitue à la superficialité relationnelle. Nous dialoguons avec des programmes comme s’ils étaient des personnes, accordons notre confiance à des marques comme à des proches. Cette confusion généralisée entre l’authentique et l’artificiel érode notre capacité à distinguer la vraie communion de la simple communication.
Pire : cette inflation de fausses voix crée un bruit de fond permanent qui couvre les vraies paroles. Quand tout parle, plus rien ne dit vraiment quelque chose. Le contraste avec Melville est saisissant : là où sa baleine parlait pour révéler l’inconnu, nos objets bavardent pour vendre du connu.
Ce que nous perdons dans cette mascarade
Cette dégradation révèle un appauvrissement plus profond : nous perdons notre rapport au mystère. La vraie prosopopée littéraire nous confrontait à l’altérité radicale – cette baleine qui nous regardait avec des yeux d’abîme. Elle nous forçait à sortir de notre nombrilisme pour écouter d’autres voix, d’autres sagesses.

Les fausses voix contemporaines font exactement l’inverse : elles nous renvoient à nous-mêmes, flattent nos désirs, confirment nos préjugés. L’algorithme qui « vous comprend » ne fait que restituer une version lissée de vos propres attentes. Aucune altérité, aucune surprise, aucune révélation – seulement un miroir déformant.
Nous confondons désormais communication et communion. Communiquer, c’est échanger des informations ; communier, c’est partager une essence. Quand Melville fait « parler » sa baleine, il nous fait communier avec l’immensité océanique. Quand Siri nous « répond », elle ne fait que traiter des données. La différence ? La première expérience nous transforme, la seconde nous confirme.
Retrouver la vraie voix du silence
Face à cette cacophonie de fausses intimités, l’urgence est de retrouver le silence fertile d’où naît la vraie prosopopée. Celle qui ne cherche pas à vendre mais à révéler, qui ne flatte pas mais interroge, qui ne rassure pas mais éveille.
Cet éveil passe par une résistance active : refuser l’anthropomorphisation marchande, débusquer les manipulations linguistiques, retrouver le goût pour les œuvres qui nous laissent sans voix plutôt que de nous abreuver de paroles creuses. C’est exactement cette exigence que développe l’analyse de l’art subtil de la suggestion, qui montre comment les vrais auteurs savent faire parler le non-dit.
La prosopopée authentique nous rappelle une vérité oubliée : les plus belles voix sont souvent celles qui ne parlent pas avec des mots. La baleine de Melville, le vent de Bernanos, la montagne de Ramuz – toutes ces présences muettes nous en disent plus long sur la condition humaine que mille discours publicitaires.
Alors, écrivains et lecteurs d’aujourd’hui, saurons-nous encore entendre ces voix silencieuses ? Ou continuerons-nous à nous contenter du bavardage de nos assistants virtuels ? La réponse déterminera peut-être l’avenir même de la littérature.