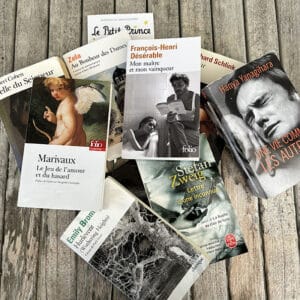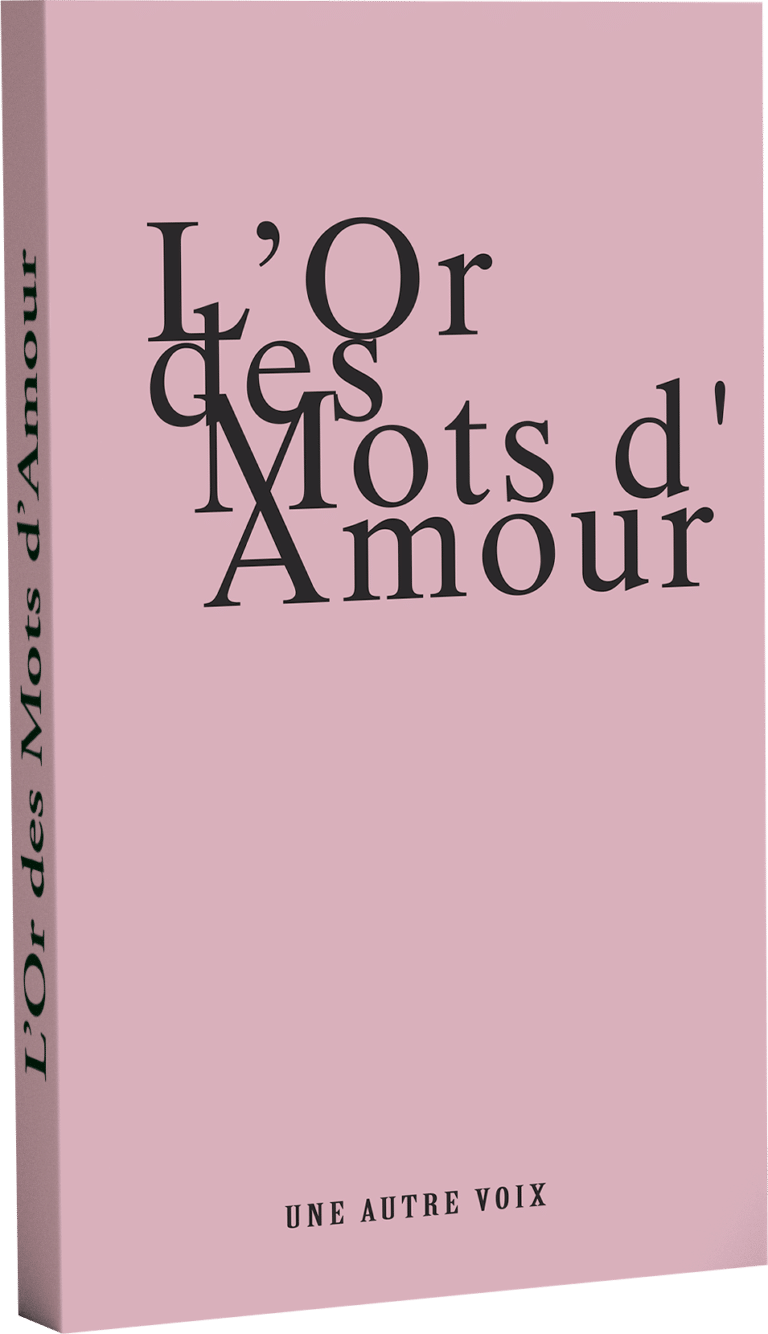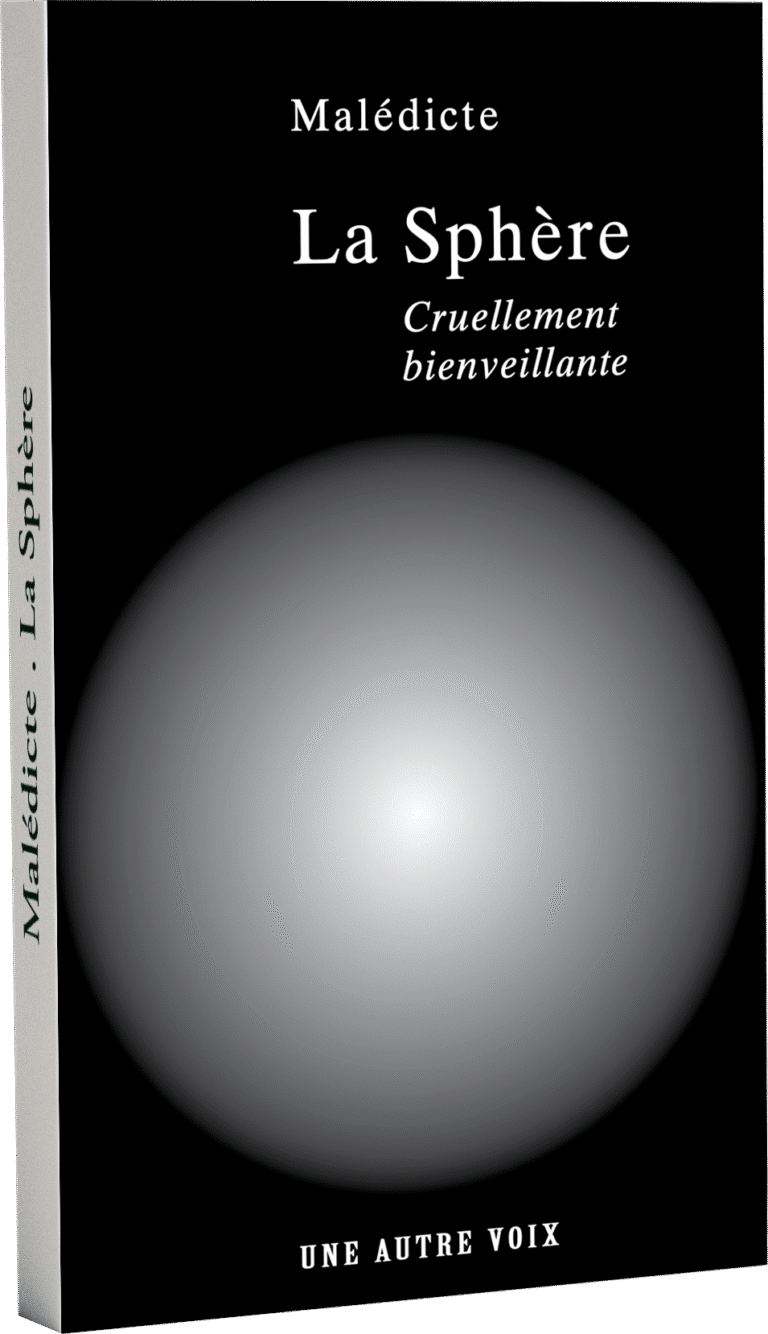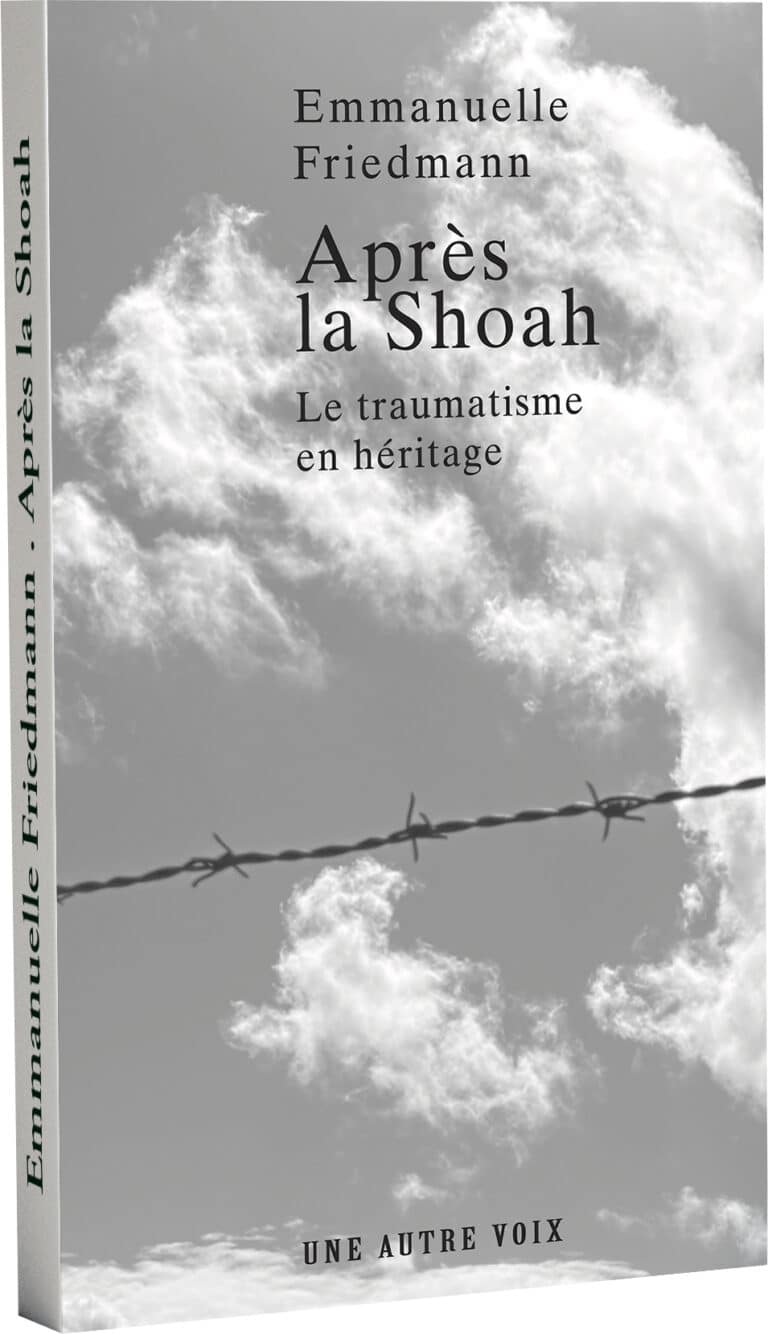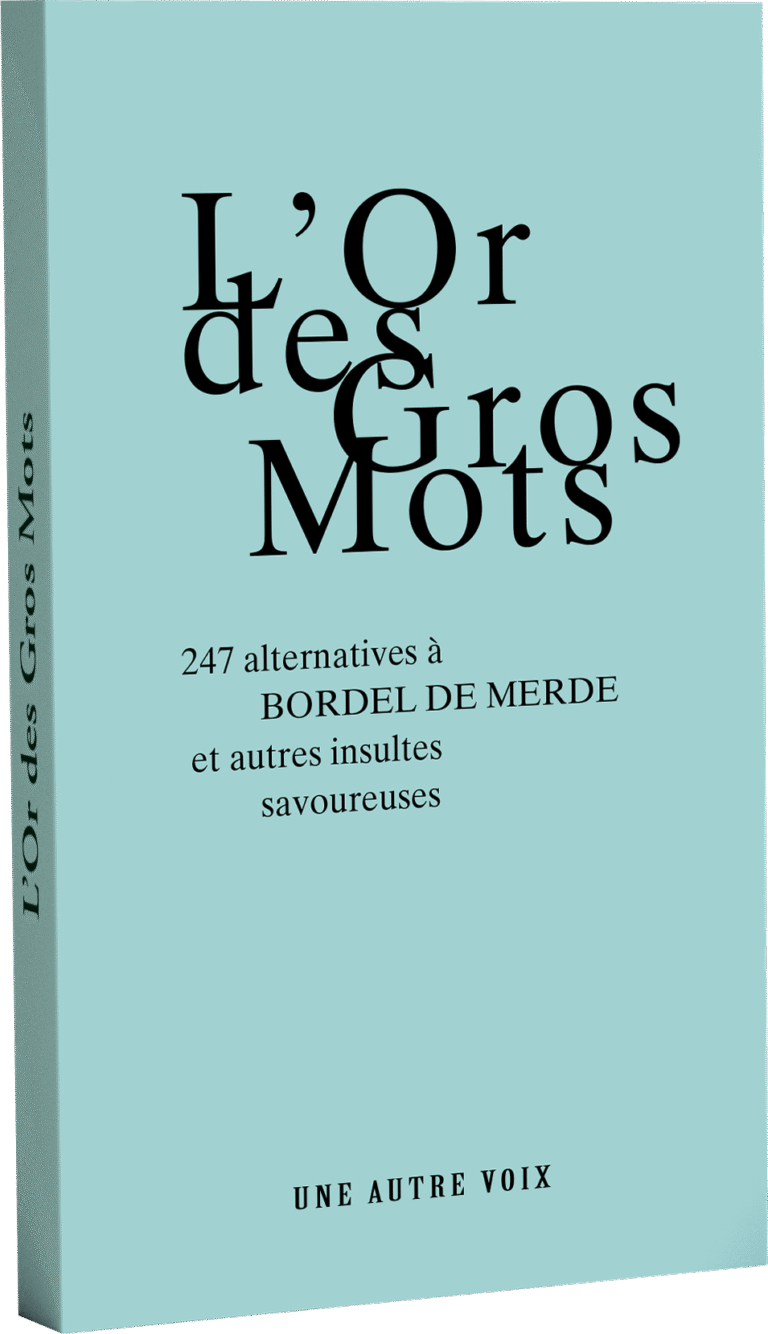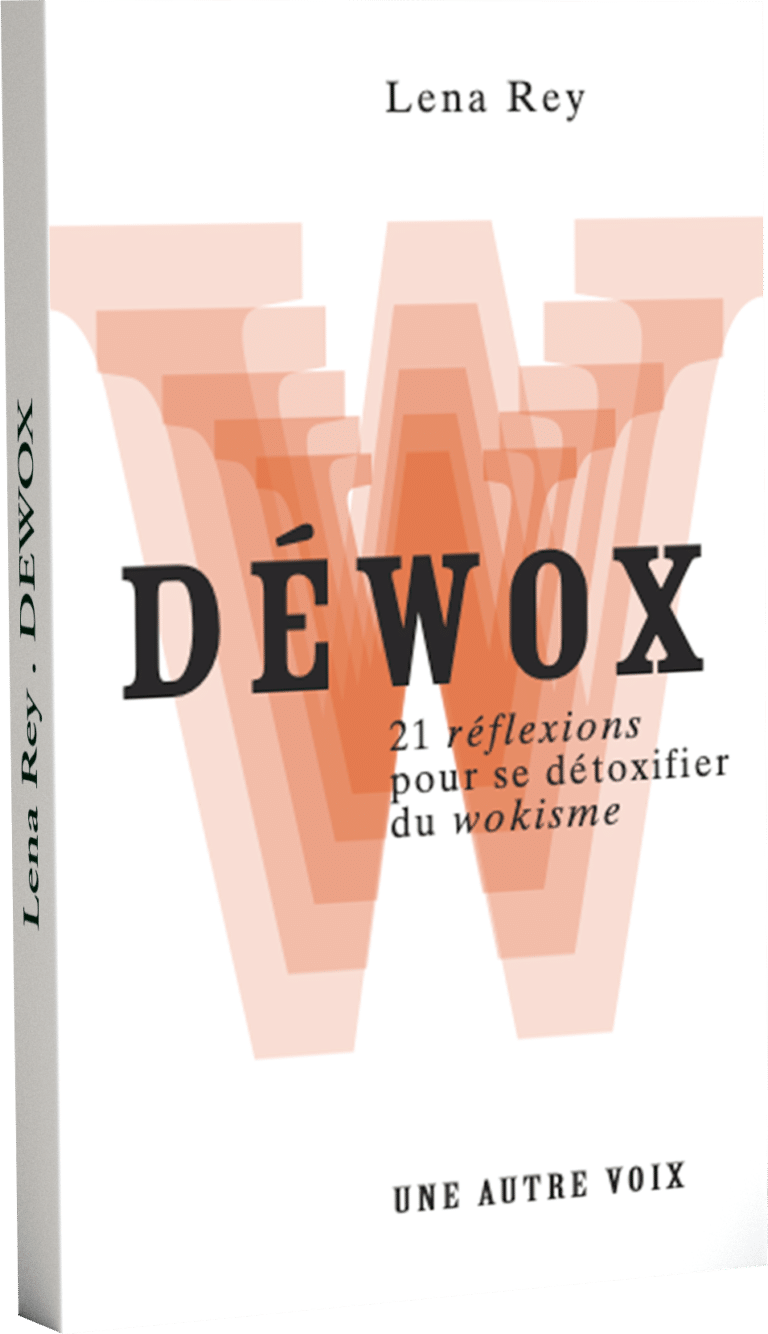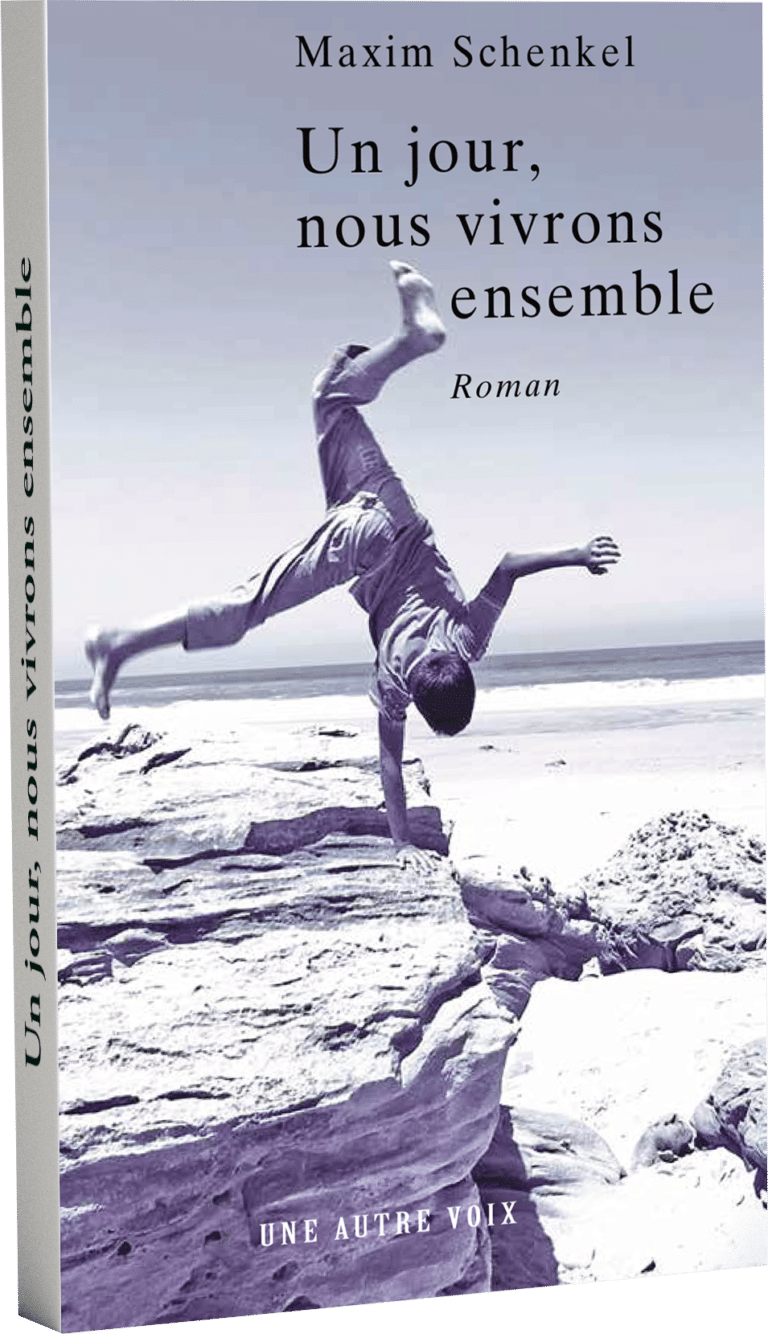« Désolée, je suis en retard, j’ai eu un appel important. » « Pardon pour hier soir, j’étais vraiment pas dans mon assiette. » « Excusez-moi, mais avec mon TDAH, c’est compliqué de me concentrer. » L’excuse est devenue notre langue maternelle, notre réflexe pavlovien face à la moindre contrariété. Nous vivons dans l’ère de l’innocence perpétuelle, où chaque erreur, chaque échec, chaque comportement répréhensible trouve instantanément sa justification externe.
Cette multiplication des excuses révèle un phénomène plus profond qu’un simple manque de courtoisie : nous assistons à l’effacement progressif de la responsabilité individuelle au profit d’un système de justifications permanentes. Mais d’où vient cette compulsion à toujours avoir une explication qui nous décharge de nos actes ?
Le grand inventaire des déresponsabilisations
Nos contemporains ont développé un art consommé de l’excuse. Plus besoin d’invoquer le traditionnel « j’ai oublié » : nous disposons désormais d’un arsenal sophistiqué de justifications psychologiques, sociologiques et identitaires. Le traumatisme intergénérationnel explique nos difficultés relationnelles, la charge mentale justifie notre désorganisation, la masculinité toxique excuse l’agressivité masculine, le syndrome de l’imposteur légitime notre procrastination.
Le plus troublant dans ce processus, c’est sa banalisation. L’excuse n’est plus l’exception qui confirme la règle de la responsabilité, elle EST devenue la règle. Nous évoluons dans une société où l’anormal serait d’assumer pleinement ses actes sans invoquer une circonstance atténuante.
Quand l’État-thérapeute fabrique l’irresponsabilité
Nos institutions participent activement à cette culture de l’excuse. L’école explique l’échec scolaire par les inégalités sociales plutôt que par le manque de travail, encourageant implicitement élèves et parents à chercher des responsables extérieurs. Les entreprises forment leurs managers à « comprendre les résistances au changement » au lieu d’exiger des résultats, transformant l’incompétence en problème d’accompagnement.
La justice elle-même s’est convertie à cette logique déresponsabilisante. Les circonstances atténuantes se multiplient : enfance difficile, milieu social défavorisé, troubles psychologiques non diagnostiqués. Le coupable devient progressivement une victime de ses propres circonstances, un automate programmé par des forces qui le dépassent. Cette approche « compréhensive » se pare des atours humanistes, mais elle produit l’effet inverse : elle nie la dignité morale de l’individu en le réduisant à un objet ballotté par ses déterminismes. Refuser à quelqu’un la possibilité d’être responsable de ses actes, c’est lui dénier sa qualité de sujet libre.
L’exemple du mouvement #MeToo illustre parfaitement cette mécanique. Comme le montre magistralement Valérie Gans dans La Question interdite, cette révolution nécessaire s’est muée en une logique où la parole de la victime devient indiscutable, où douter équivaut à trahir la cause. Adam Lepage, le héros du roman, découvre que sa présomption d’innocence s’évapore face à l’impératif victimaire : il DOIT être coupable puisqu’on l’accuse.
Le conditionnement au victimisme
Nous subissons une forme subtile de conditionnement collectif qui nous programme à l’irresponsabilité. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène en récompensant l’exposition de nos blessures : chaque trauma partagé génère compassion et validation. Cette économie de l’attention transforme la souffrance en capital social, incitant chacun à cultiver son statut de victime.
Stanley Kubrick nous montrait dans Orange mécanique comment une société peut programmer un individu à être incapable de violence. Notre époque a inventé plus pernicieux : elle nous conditionne à être incapables de responsabilité. Nous apprenons dès l’enfance que nos difficultés viennent toujours d’ailleurs – parents défaillants, école inadaptée, société injuste – jamais de nous-mêmes. Cette programmation à l’irresponsabilité produit des adultes infantilisés, convaincus que leurs problèmes relèvent d’une thérapie collective plutôt que d’un effort personnel. L’individu contemporain devient un patient perpétuel d’une société-hôpital chargée de soigner tous ses maux.

Cette culture de l’excuse permanente détruit progressivement le lien social. Comment faire confiance à quelqu’un qui a toujours une justification pour ses manquements ? Comment construire ensemble quand chacun se défausse systématiquement de ses responsabilités ? L’excuse généralisée crée une société de défiance où personne n’ose plus exiger quoi que ce soit de personne. Nous marchons sur des œufs, craignant de « déclencher » quelqu’un en pointant ses défaillances. Cette hypersensibilité collective nous enferme dans un déni de réalité où l’erreur devient innommable.
Le paradoxe de notre époque tient dans cette prétention à l’émancipation par la déresponsabilisation. Nous pensons libérer l’individu en le débarrassant du poids de ses actes, mais nous ne faisons que l’enfermer dans une nouvelle aliénation. Car être humain, c’est précisément pouvoir répondre de ses choix, même mauvais.
Retrouver le goût de la responsabilité individuelle n’est pas nostalgie moralisatrice, c’est urgence démocratique. Une société d’éternels excusés ne peut pas être une société d’adultes libres. Il est temps de redécouvrir cette vérité dérangeante : nous sommes responsables de nos actes, et c’est précisément ce qui nous rend humains.