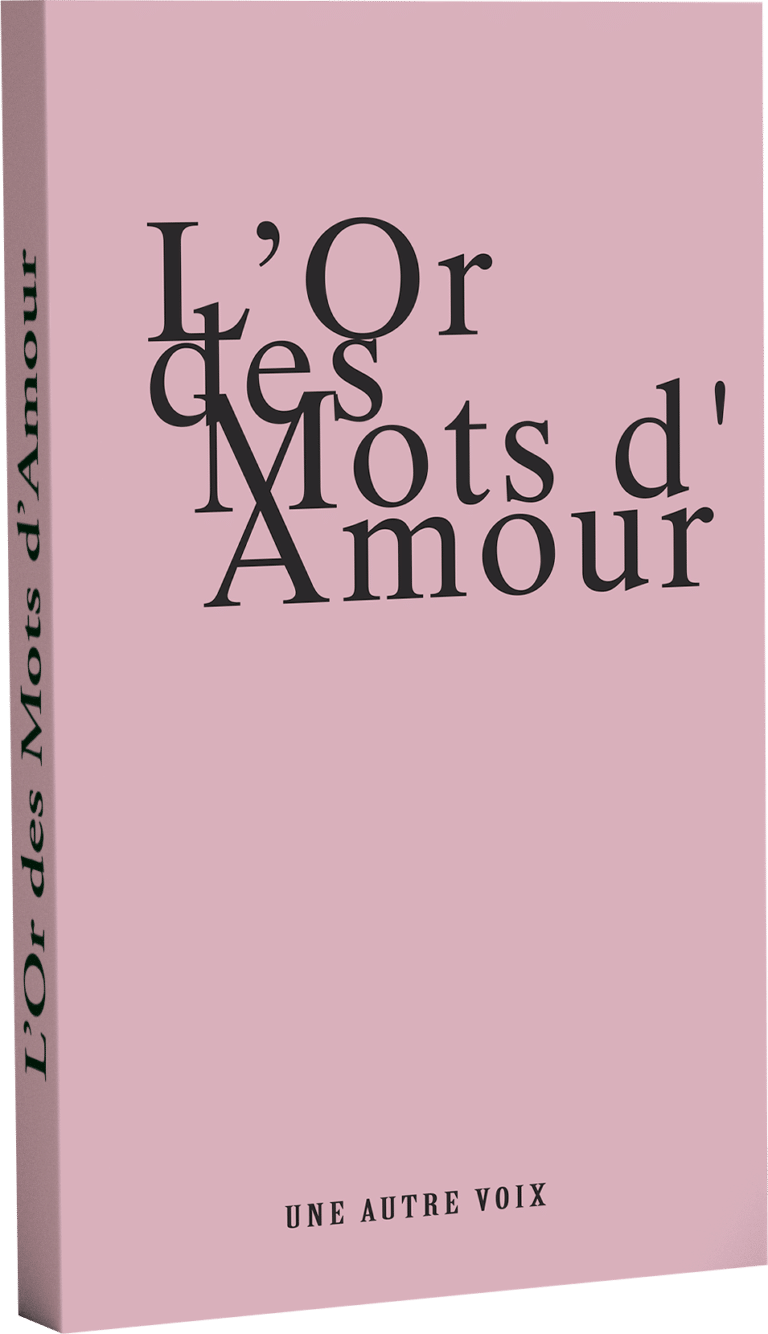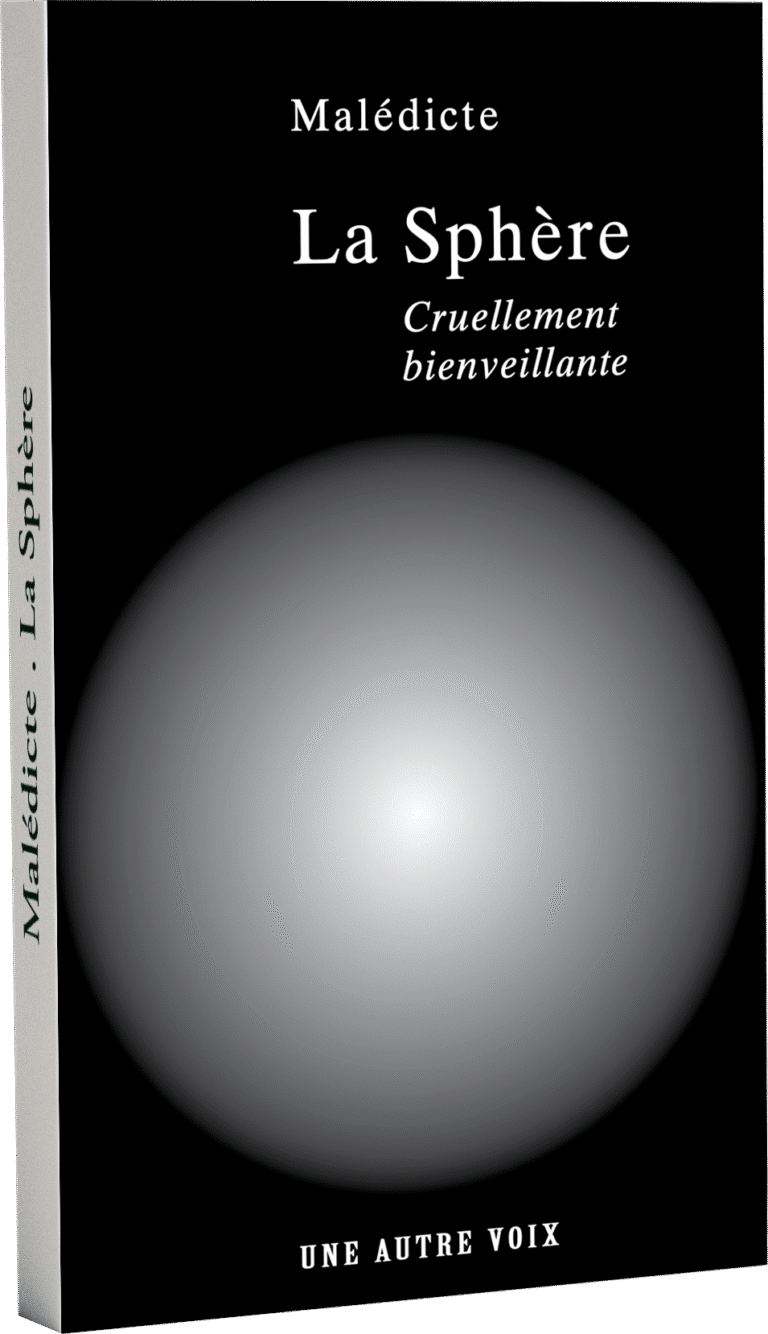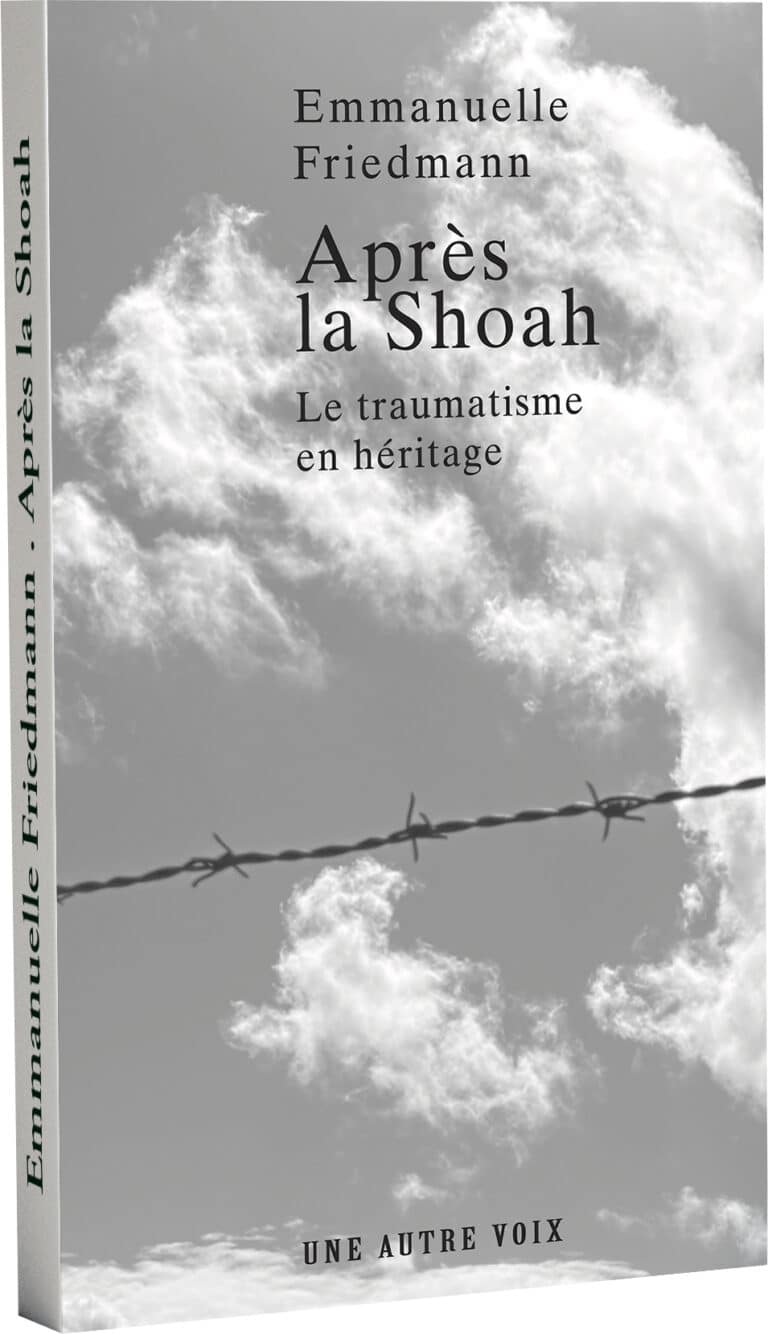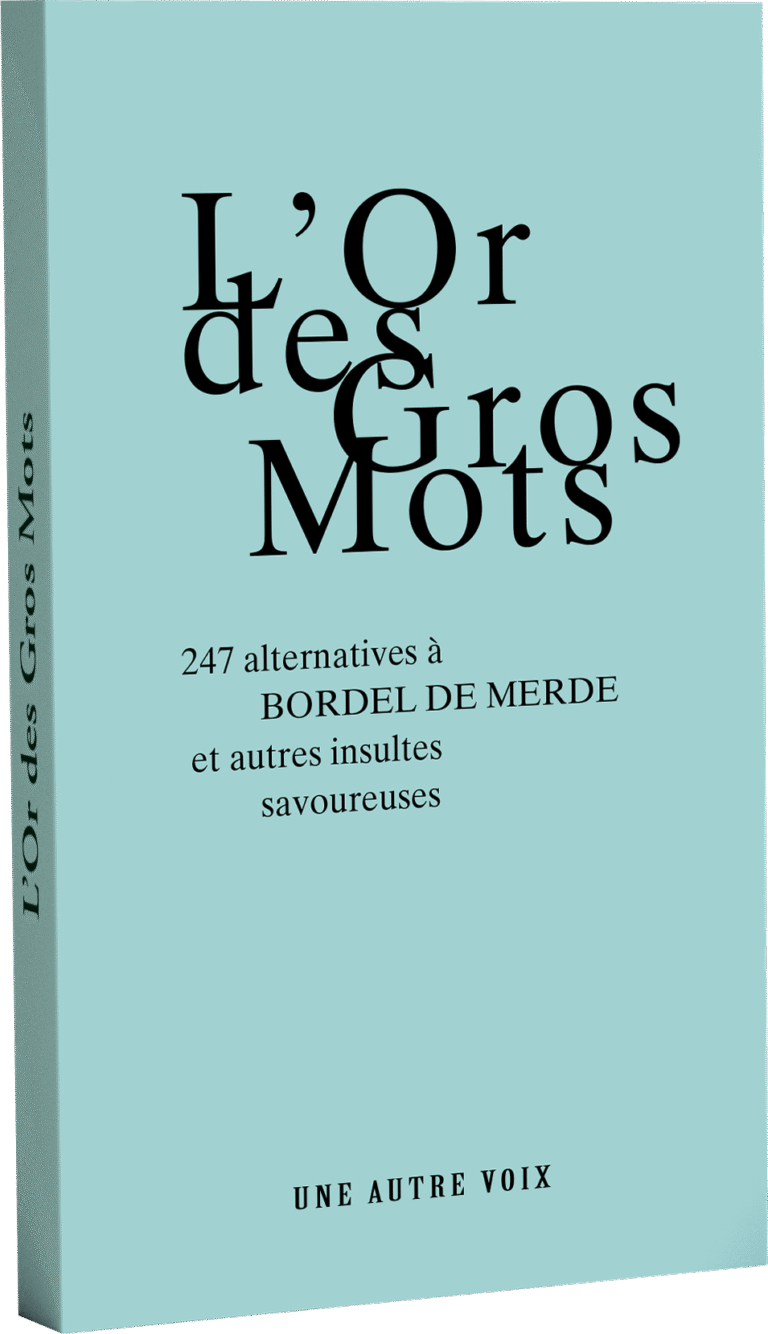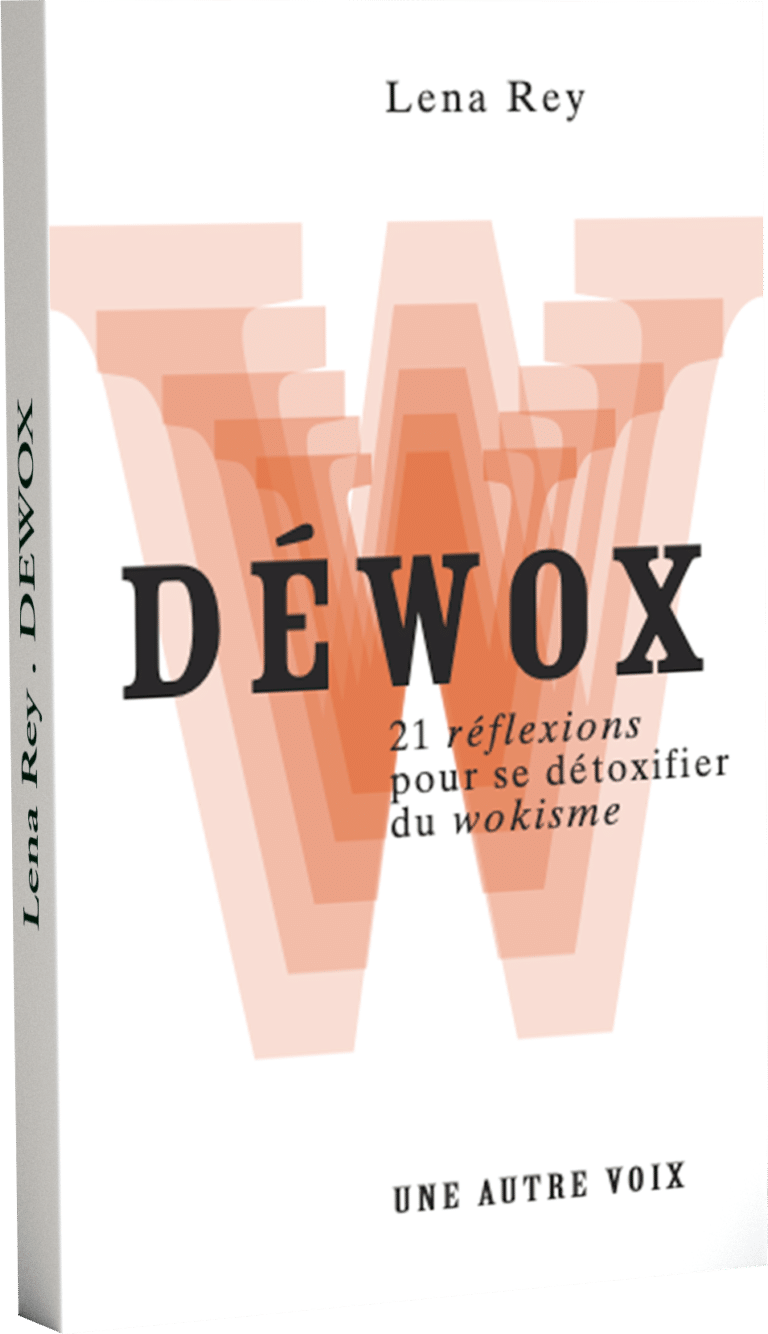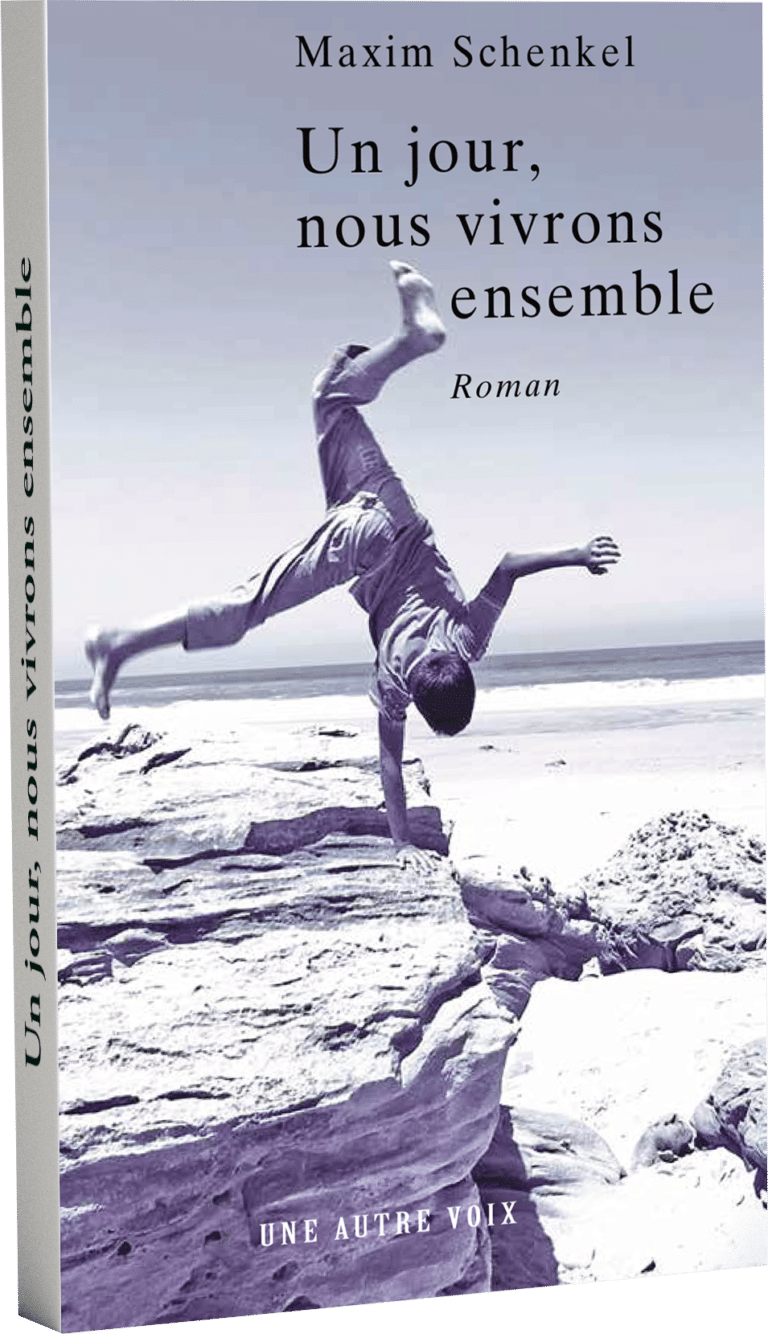Force est de constater que l’Histoire et son enseignement ont de plus en plus mauvaise presse. Ceux-ci sont devenus au fil des ans, wokisme débridé aidant, l’objet d’attaques régulières, dont la fréquence ne saurait être fortuite.
L’Histoire en crise : Wokisme et érosion de l’enseignement traditionnel
Décriés en son temps par Najat Vallaud-Belkacem, dernière et déplorable Ministre de l’Education Nationale sous la Présidence de François Hollande (de 2014 à 2017), qui aimait ironiser sur un supposé roman national, ils avaient déjà été, quelques années plus tôt, la cible de Richard Descoing, problématique directeur de l’IEP de Paris (Sciences Po). À ses yeux, l’Histoire et son enseignement portaient, prétendument, le défaut rédhibitoire de favoriser les discriminations sociales. Du reste, il semblerait bien que chez ce produit, pourtant culturellement fort nanti, de la méritocratie républicaine (Sciences-Po, l’ENA et le conseil d’État), toute discipline supposant un bagage culturel un tant soit peu solide fût suspectée de manquer au sacro-saint devoir d’inclusivité !
Critiques et défense de l’enseignement traditionnel de l’histoire
Peu importe que la IIIe République ait prouvé tout l’inverse en s’attachant avec succès à dispenser un tel enseignement à toute une classe d’âge, consciente ce faisant de renforcer le sentiment national! Elle s’adonnera à cette tâche en respectant la chronologie, qui seule permet de comprendre les liens de causalité entre les faits historiques et leurs conséquences. Peu importe également que l’historien René Rémond ait pu souligner, précisément dans ses cours aux Sciences-Po, tout ce que l’Histoire pouvait apporter à la compréhension actuelle des conflits ou des antagonismes entre les peuples et les états, en permettant de remonter à leurs racines. Oui, peu importe tout cela et enterrons donc joyeusement l’Histoire et la culture générale au nom d’une vulgate « bourdienne » sommaire et mal digérée !
Comme le soulignait avec ironie Jean-Eric Schoettl* dans une de ses chroniques du Figaro, on se soucie en général assez peu de savoir si nos diplômés des facultés de médecine sont représentatifs de la nouvelle diversité française car l’on est davantage préoccupé de la qualité de son médecin que de son origine. Peut-être concluait-il, serait-on bien avisé de se poser la même question s’agissant de la formation de nos hauts fonctionnaires ? Car en définitive qu’est-ce qu’un jeune diplomate dépourvu d’une bonne maîtrise de sa langue et sans culture générale ? Un bien triste sire, fort inutile de surcroît !
Il me vient à l’esprit l’analyse pertinente d’un critique musical des compositeurs les plus marquants des écoles nationales du début du XXe siècle. En particulier, s’agissant de l’œuvre du grand Béla Bartók, aimait souligner ce qu’elle devait à ses racines hongroises et au folklore magyar tout en les transcendant pour délivrer un message profondément universel. Conclusion : pour savoir où l’on va, il n’est peut-être pas inutile de savoir d’où l’on vient !
Redéfinir la nation : l’âme collective selon Renan
Comment ne pas faire à ce propos le parallèle avec la pensée d’Ernest Renan et son texte magistral, Qu’est-ce qu’une nation ? fruit d’une conférence que cette figure intellectuelle majeure de son siècle prononça, le 11 mars 1882, à La Sorbonne? Démontrant qu’une nation ne se définit guère par une illusoire homogénéité ethnique, ni, depuis les temps modernes et en particulier en Occident, par la commune appartenance à une religion, le fait religieux étant désormais « une chose individuelle, regardant la conscience de chacun », il notait qu’elle n’était pas davantage définie par une entité géographique : « ni le cours des fleuves, ni la direction des chaînes de montagnes ». Pas même, quelle que soit l’importance de ce critère, par une langue commune, soutenait-il, en citant le cas de la Suisse.
Non, affirmait Renan, une nation est « une âme , un principe spirituel » qui s’appuie sur deux choses : « l’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de faire vivre l’héritage que l’on a reçu indivis ». Quand l’homme « s’agrège avec ses congénères », il crée « une conscience morale ». « Tant que cette conscience morale prouve sa force par le sacrifice qui exige l’abdication de l’individu au profit d’une communauté, elle est légitime, elle a le droit d’exister ».
L’Essence de la Nation : Mémoire Partagée et Volonté Commune
Sinon…, « sinon mieux vaut ne pas y penser », comme le remarque Franz Olivier Giesbert dans le deuxième tome, la Belle Époque, de son histoire intime de la Ve République. Et, pessimiste, de conclure : « que sera devenu notre pays quand cette définition de la nation, consciencemorale, aura fini de perdre son sens et que nous serons ramenés à l’état de ramas de communautés se regardant en chiens de faïence ? Comment avons-nous pu à ce point dégringoler la pente», depuis ces 40 dernières années ?
L’Histoire comme ciment d’une nation ! Mais aussi, quand elle est enseignée sans présupposé idéologique, et même si c’est moins souvent souligné, comme propédeutique d’une pensée fine, nuancée, capable de mettre en situation les hommes et les faits ou, comme on le dirait aujourd’hui en étant un brin pédant, de les contextualiser. En un mot l’Histoire comme école de la nuance et de la tolérance !
Ne cherchons pas plus loin la haine que nourrissent à son égard tous les Torquemada du wokisme ivres de leur furie déconstructrice, de leurs délires et de leur viscérale intolérance. Oui, décidément, il est vraiment grand temps d’en finir avec le véritable lavage de cerveau que subit la jeunesse occidentale, victime du tribunal médiatique d’une bien-pensance d’autant plus insupportable qu’elle est auto-proclamée et qu’elle sert le plus souvent de misérable cache-sexe à un sectarisme absolu !
*Jean-Eric Schoettl : Conseiller d’État honoraire, ancien secrétaire général du Conseil Constitutionnel (1997-2007)