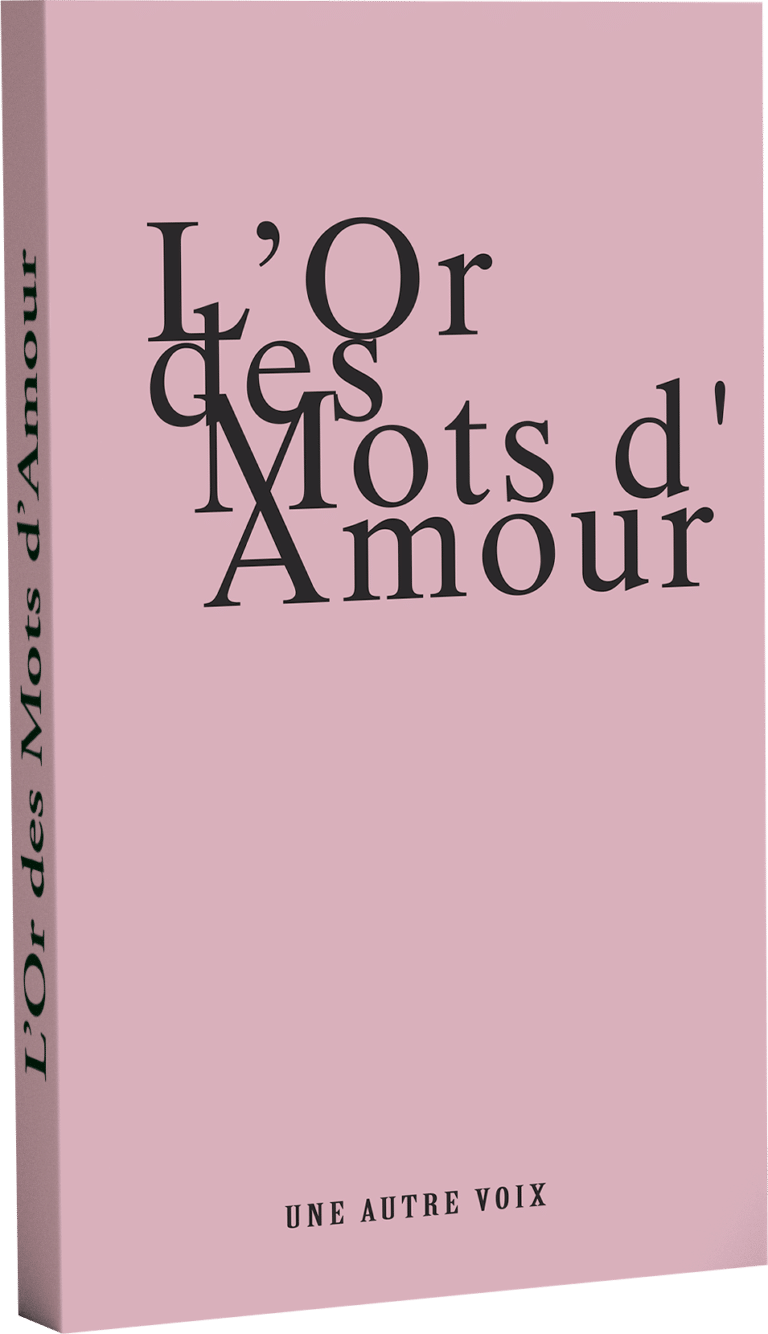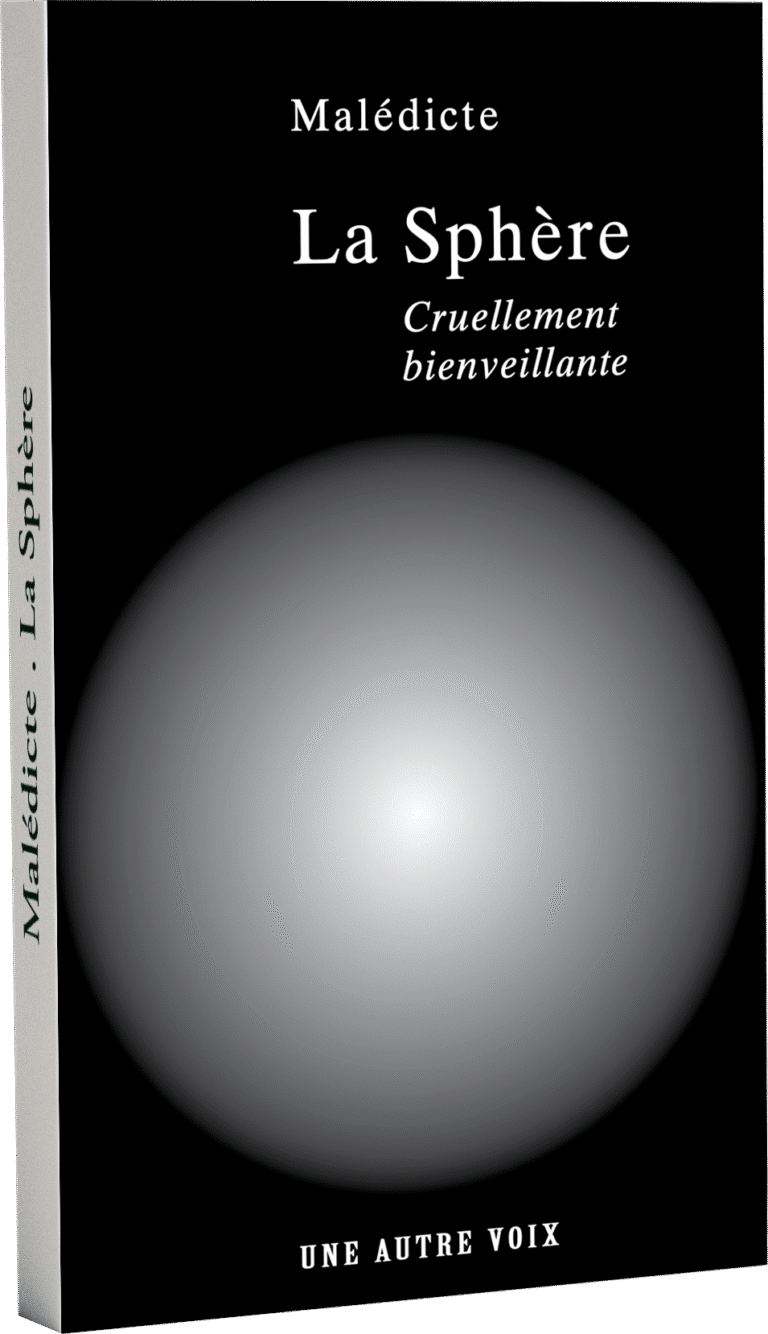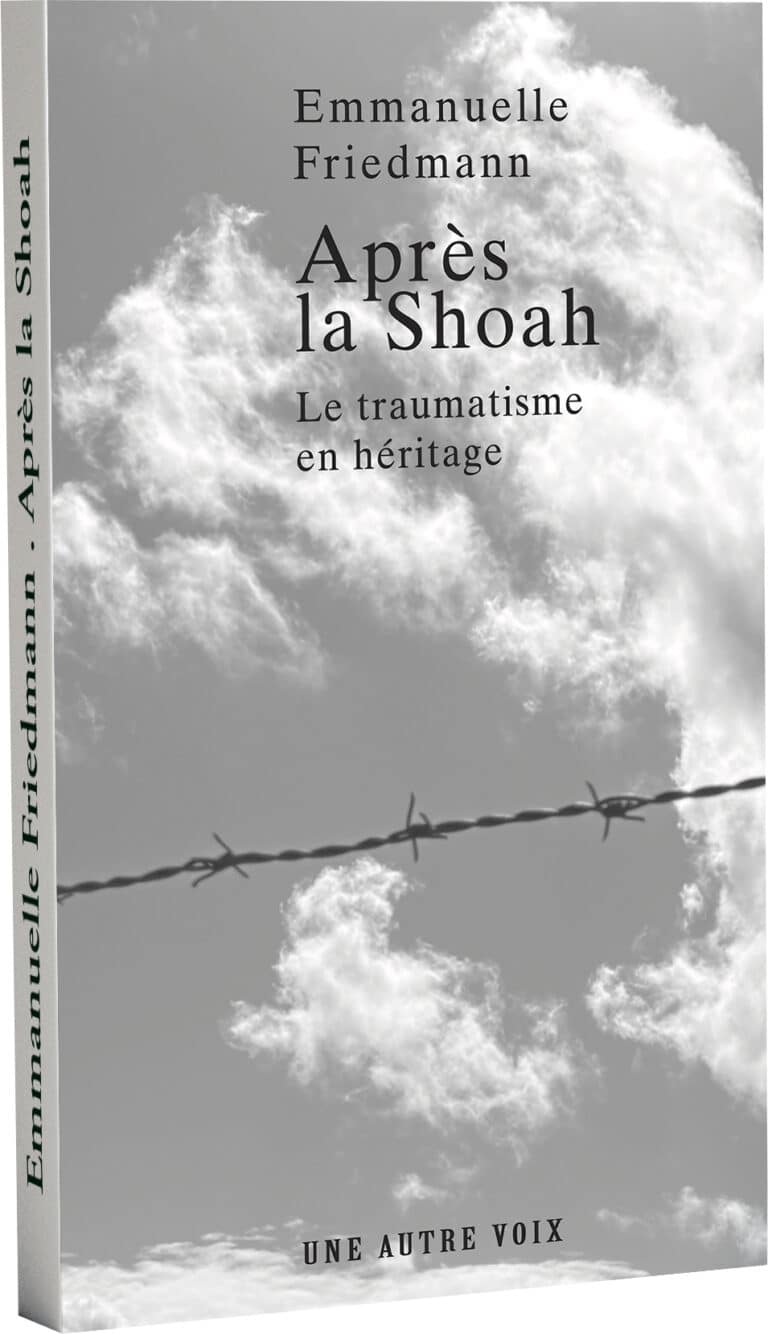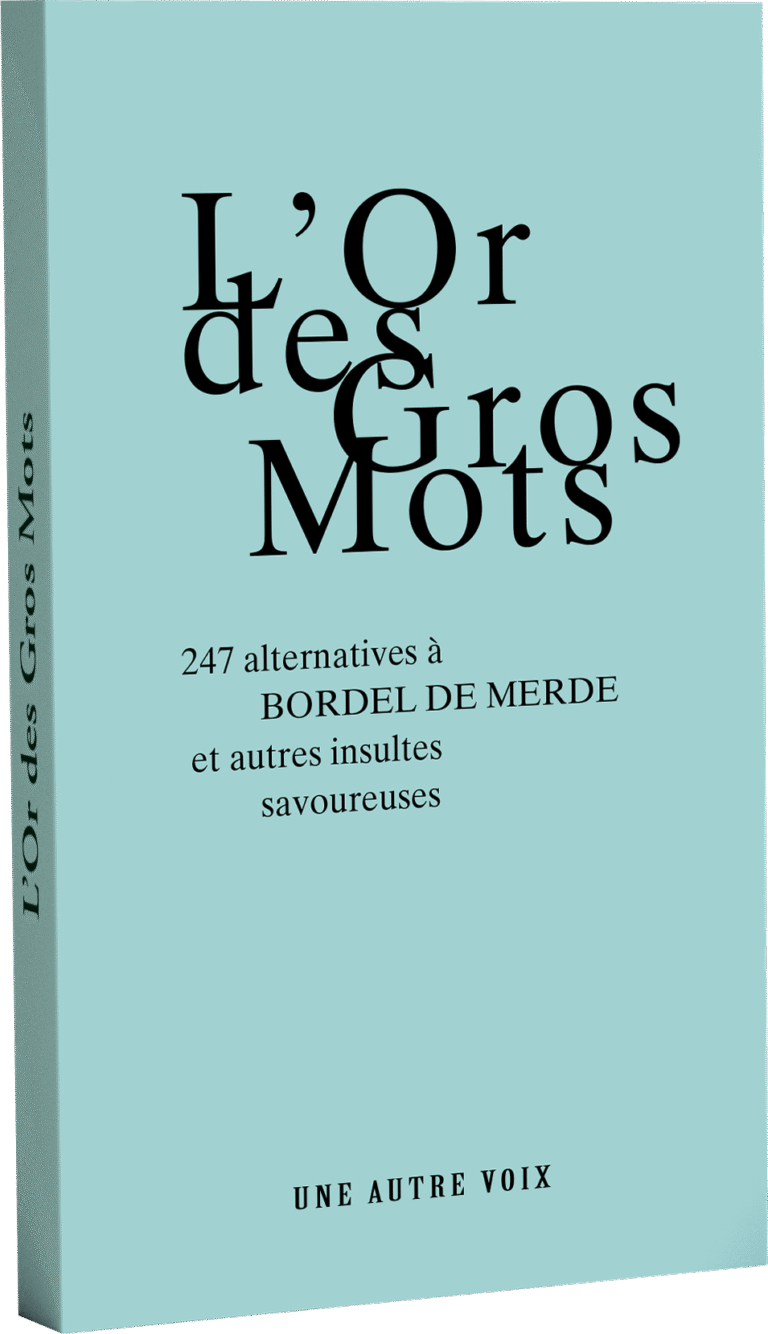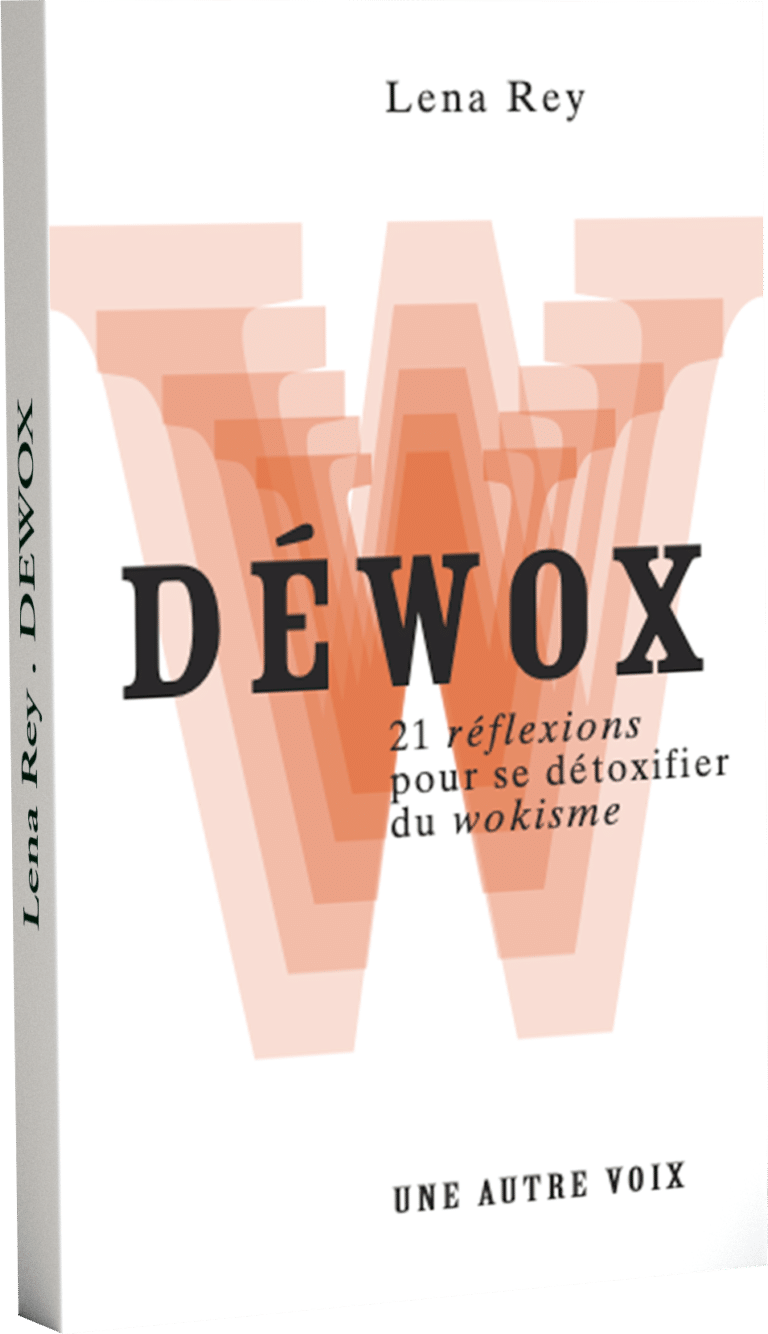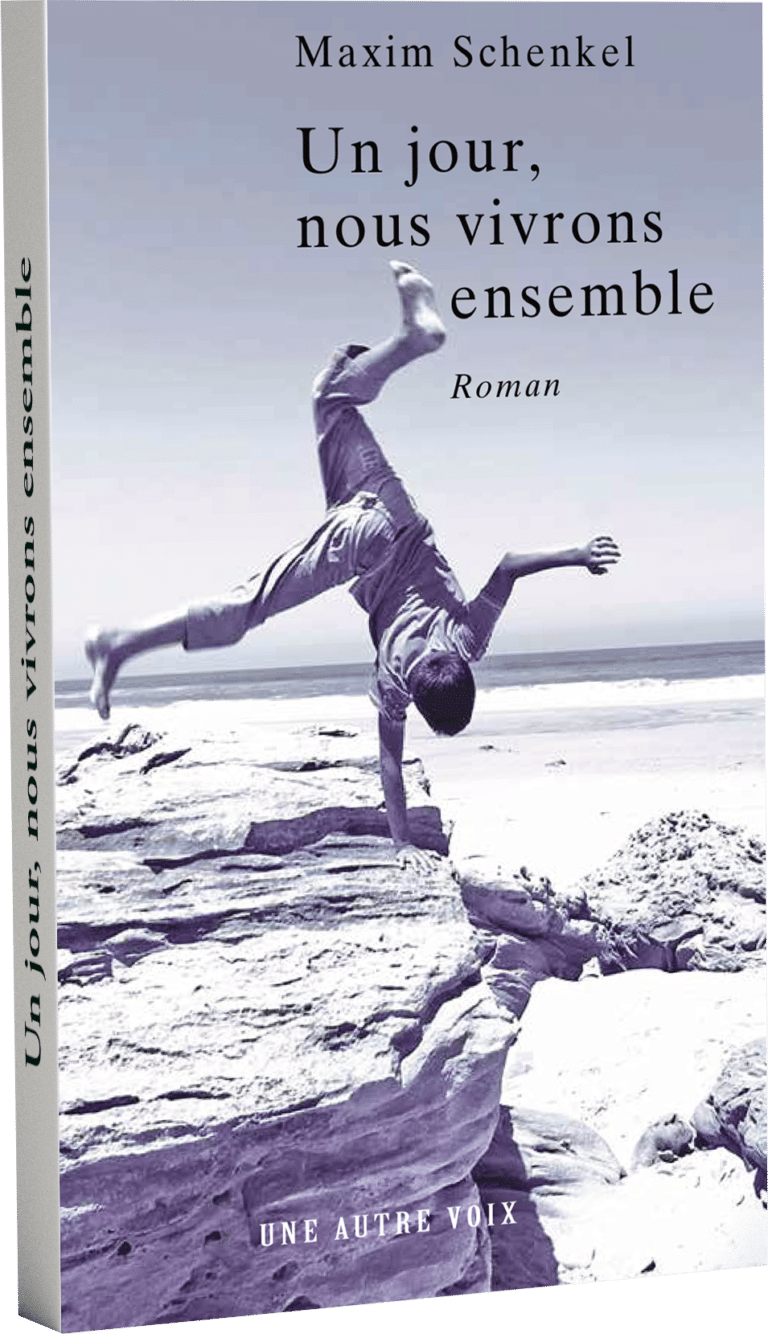Marie, huit ans, franchit la ligne d’arrivée du cross scolaire avec cinq longueurs d’avance. Ses joues sont rosies par l’effort, ses yeux pétillent de fierté. Mais voilà que l’institutrice fronce les sourcils : cette victoire trop éclatante risque de « décourager » les autres enfants. La solution moderne tombe comme un couperet : suppression du classement. Tout le monde gagne, personne ne perd, et surtout… personne ne grandit vraiment.
Cette petite scène, banale dans nos écoles contemporaines, révèle l’ampleur d’une dérive qui dépasse largement le cadre scolaire. Notre époque a transformé la noble aspiration à l’égalité en une obsession du nivellement qui broie méthodiquement tout ce qui dépasse, tout ce qui brille, tout ce qui ose être singulier.
De l’équité à la tyrannie égalitaire
Il existait autrefois une distinction fondamentale entre égalité des chances et égalité des résultats. La première offrait à chacun la possibilité de développer ses talents selon ses efforts. La seconde impose que tous franchissent la ligne d’arrivée ensemble, indépendamment du parcours accompli.
Cette confusion génère des effets pervers dans toute la société. Les quotas de parité, conçus pour corriger des déséquilibres historiques légitimes, produisent parfois des situations paradoxales. Certaines entreprises écartent des candidats compétents pour respecter des équilibres statistiques, transformant le recrutement en exercice de géométrie sociale.
Plus troublant encore, ce système dessert souvent ceux qu’il prétend protéger. Combien de femmes talentueuses entendent-elles murmurer : « Elle a été promue grâce aux quotas, parce que c’est une femme » ? Cette suspicion permanente empoisonne les réussites légitimes et nourrit des ressentiments qui n’existaient pas.
L’éducation révèle d’autres symptômes de cette dérive. Dans certains établissements, on évite de récompenser l’excellence pour ne pas « décourager » les autres. On supprime les classements, on adapte les évaluations, on personnalise les parcours… avec souvent pour résultat de freiner les plus doués sans véritablement aider les plus en difficulté.

L’amour sous surveillance idéologique
Mais le plus sidérant reste l’invasion de l’égalitarisme dans nos chambres à coucher. Oui, vous avez bien lu. L’amour aussi doit désormais se plier aux exigences du nivellement parfait.
Léna Rey l’a magistralement analysé dans son livre « Déwox » : l’amour devient « l’un des rings de l’égalitarisme où l’on devrait obtenir match nul alors que l’égalité en amour n’existe pas. » Imaginez la scène : Roméo comptabilisant ses « je t’aime » pour s’assurer qu’ils équivalent exactement à ceux de Juliette. Dans la lignée de ces fameux « bodycounts » (décompte des conquêtes amoureuses) qui obsèdent tant nos influenceurs contemporains.
Cette manie du décompte permanent transforme les couples en petites entreprises de consulting relationnel. Qui exprime le plus de tendresse ? Lequel prend davantage d’initiatives ? Comment sont réparties les tâches domestiques ? Chaque geste devient suspect de domination, chaque différence une source de culpabilité. L’amour, cet art délicat fait d’élans imprévisibles et d’équilibres fragiles, se trouve réduit à une comptabilité émotionnelle d’une platitude consternante.
L’absurde atteint son paroxysme quand certains courants militants prônent l’interchangeabilité totale des rôles biologiques. Pourquoi les femmes seraient-elles les seules à porter les enfants ? Injustice de la nature ! Cette logique, poussée à son terme, finit par nier la réalité biologique au nom d’un idéal égalitaire aussi chimérique que destructeur.
Le piège des nouvelles discriminations
Le paradoxe le plus troublant de cette évolution tient dans sa capacité à reproduire, sous de nouveaux atours, les maux qu’elle prétend combattre. En voulant corriger certaines inégalités, l’égalitarisme contemporain en génère parfois d’inédites.
Les universités américaines illustrent cette dérive avec une clarté saisissante. Pendant des décennies, elles ont favorisé l’admission d’étudiants issus de minorités ethniques pour réparer des injustices historiques. L’intention était légitime. Mais cette politique a produit un effet inattendu : aujourd’hui, un jeune américain d’origine asiatique doit présenter un dossier sensiblement plus solide qu’un candidat afro-américain pour intégrer la même institution. La lutte contre les discriminations s’est muée en discrimination inversée.
En France, ces phénomènes prennent des formes plus subtiles. Certaines bourses d’études privilégient des critères géographiques ou sociaux qui masquent parfois des considérations ethniques. Des concours publics introduisent des « aménagements » destinés à diversifier le recrutement. Ces dispositifs, bien intentionnés, fragmentent progressivement la société en communautés concurrentes.
Cette logique victimaire transforme le mérite en concept suspect et l’excellence en privilège coupable. Les vraies compétences se trouvent dévaluées au profit de l’appartenance à tel ou tel groupe, créant frustrations et ressentiments dans tous les camps.
Retrouver l’équilibre perdu
Faut-il pour autant renoncer à toute forme de justice sociale ? Certainement pas. Mais il devient urgent de retrouver la distinction entre égalité des droits et égalité des résultats, entre respect de la dignité humaine et négation des différences individuelles.
Marie court effectivement plus vite que ses camarades, et cette réalité ne constitue ni un problème à résoudre ni une injustice à corriger. Elle représente au contraire une chance pour tous : celle d’avoir un modèle à suivre, un exemple qui prouve que l’effort et le talent peuvent mener quelque part. Supprimer les classements ne protège personne, cela prive simplement les enfants de la joie de progresser et de se dépasser.
Une société véritablement juste devrait offrir à chacun les moyens de développer ses spécificités tout en reconnaissant que nous ne naissons pas tous avec les mêmes aptitudes. Nos différences ne constituent pas des défauts à gommer mais des richesses à cultiver. L’harmonie sociale naît de cette diversité assumée, non de son effacement artificiel.
Face aux dérives contemporaines de l’égalitarisme, des voix s’élèvent heureusement pour proposer des analyses lucides et des outils de résistance intellectuelle. « Déwox » de Léna Rey figure parmi ces ouvrages salutaires qui aident à déconstruire les mécanismes de la pensée égalitariste et à retrouver un rapport plus sain à la différence.
Car Marie, au fond, ne demande qu’une chose : courir. Et nous ferions bien de la laisser faire, tout en apprenant aux autres que la course, comme la vie, récompense ceux qui osent s’élancer.